Le vrai cinéma
J’espère partir comme un vieux con aigri, désespérant de toute forme d’art, me souvenant de l’âge d’or où tout était mieux, pour me dire : bon, ça y est, c’est fini, plus rien à découvrir, donc pas la peine de rester.
Pouf pouf…
Scorsese nous annonce qu’il ne voit rien de passionnant dans l’univers ciné de Marvel. Selon lui, ces films ne sont pas réalisés par “des êtres humains qui veulent transmettre des émotions”. Eh ben merde alors. Ca m’a fait réfléchir (une fois n’est pas coutume, diront les trous de balle du fond : je vous vois. I see you, you little holes of bullets !).
C’est une opinion (tout à fait argumentable), mais une opinion à laquelle je n’adhère pas, mais alors pas du tout.
Scorcese enchaîne sur cette époque lointaine et bénie où on faisait des films sur de vrais personnages, du “vrai cinéma” donc (en oubliant au passage que l’époque dont il parle était particulièrement riche en films d’exploitation et autres séries B, voire Z, mais mettons).
Il y aurait selon lui un vrai cinéma (rare) et un faux cinéma (celui qui joue les “parcs d’attraction” et qui n’est donc pas du cinéma).
Et ça, je trouve ça furieusement con. Il n’y a pas de “vrai” ou de “faux” cinéma. Pas de bol : le ciné, c’est le ciné. Même le ciné qu’on n’aime pas.
Moi, le ciné d’aujourd’hui, je l’aime bien. J’aime bien voir fleurir des trucs improbables (Mother), bouleversants (Midsommar), fun (plein de films). J’aime bien l’entertainment pur jus, celui qui est là pour te faire plaisir, ce qui ne l’empêche pas de te faire réfléchir à l’occasion. Un cinéma qui serait au service du public. Alors que le cinéma “auteurisant” me fait généralement chier parce que… eh ben parce qu’il est au service de quelqu’un d’autre (c’est écrit sur l’étiquette, comme le Port-Salut). Et le plus noble des deux, à mes yeux du moins, n’est pas celui qu’on croit. J’aime le ciné généreux d’un Guillermo del Toro. J’aime les films un peu foutraques, et j’aime les blockbusters (mon film préféré étant le premier d’entre eux, Les Dents de la mer).

J’aime plein de trucs. Ouais, je me souviens de belles périodes ciné (les années 1980), mais de là à dire : “tout était mieux avant”, oh poutrin, non.
Je me dis encore que le meilleur est à venir, avec des films inclusifs, et les innombrables formes de narration qui ne devraient pas manquer d’accompagner la (trop) lente déliquescence de la narration patriarcale, sexiste et raciste qui prédomine depuis toujours (ce qui ne m’empêche pas de toujours apprécier des machins bien sexistes, mais en percevant désormais leurs gros défauts et en me disant : dommage).
Je vois plein de choses merveilleuses. “Je vois des bons films. PARTOUT.” Je suis bien content d’être câblé comme ça, plutôt bon public, avec de solides bretelles à suspension d’incrédulité. Je suis bien content d’être fromage ET dessert.
Alors je révise ma déclaration de début de post.
J’espère ne partir QUE quand je serai un vieux con aigri se souvenant de l’âge d’or où tout était mieux. Ca devrait me laisser un sacré bout de temps devant moi.
La bises à toutes les créatives et à tous les créatifs.
Double Feature : John Rambo et Midsommar
Double feature un peu spécial ce vékande, avec deux films vus sur une taylay, et non un écran de ciména.
Comme d’hab, ça va spoiler velu, vous êtes prévenu.es.
John Rambo (2008)

Oui, le John Rambo intitulé Rambo au Québec, parce qu’au Québec, Rambo (dit « Rambo un », voire « Rambo, hein ? » en France) s’intitulait Rambo le Dévastateur. Alors qu’aux zétazinis, c’est Rambo First Blood (alias « Rambo tombe à vélo et s’écorche les genoux : il ne s’en remettra pas et s’engage dans l’armay des zétazinis »).
Euh, bon, en fait c’est Rambo 4. Dans les années 1980-90, c’était la classe de mettre un numéro après le nom d’une suite, aujourd’hui c’est la lose, il faut croire. En tout cas, ça ne facilite pas la tâche au cinéphile un peu distrait. Bon, l’essentiel, c’est : je ne vais pas vous parler du Rambo qui sort au ciné en ce moment (septembre 2019 donc), mais du précédent.
Recommandé par des gens que j’apprécie beaucoup (et qui vont probablement me jeter de petits cailloux pointus après cet article, je les entends déjà poncer des silex), le film est bâti selon un schéma classique : Rambo est parti capturer des serpents venimeux en Thaïlande et oublier toutes ces conneries de guerre de mon cul, il est peinard à choper de la vipère aquatique super dangereuse à mains nues, quand soudain, arrivent des gens qui ont une furieuse envie de le faire chier.
Et ces gens, comme souvent les gens qui font chier quand on est peinard, sont des prosélytes qui veulent passer en loucedé en Birmanie pour aller refourguer des bibles et du prêchi-prêcha à des pauvres paysans Birmans qui sont déjà bien embêtés d’être chrétiens dans un pays où c’est un peu un ticket gratuit pour une partie de « attrape la balle de fusil avec tes organes ».
Ca commence plutôt intelligemment, avec ces prosélytes qui sont aussi médecins, donc pas complètement inutiles, et qui ont grave la foi : la petite nana sympa mais inaccessible parce que son mec fait partie de l’expédition explique bien à Rambo que non, tout n’est pas perdu pour lui, qu’il a beau faire celui qui s’en fout et qui passe tranquillement ses nuits en PTSD, il se soucie encore de son prochain. Ou de sa prochaine. Et ça tombe bien, des prochains, elle en a un plein bateau à convoyer jusqu’en Birmanie alors secoue-toi, John, enfin, tu vois bien que c’est important.
Ce qui n’est pas si con.
D’une part parce qu’on sent arriver une escouade de bons persos blancs bien privilégiés à bloc qui débarquent avec leurs bites (pour la majorité d’entre eux) mais même pas de couteau dans un pays en guerre, et qu’il y a peut-être une morale rigolote à en tirer. D’autre part parce que…
BOUM !
Ca, c’est le bruit des Birmans opprimés qui sautent sur des mines. Krakka-boom ! Ca, c’est le bruit de leurs copains et copines massacrés par une junte infecte menée par un officier pédophile. Pendant une séquence d’exactement huit heures, nous assistons donc aux déprédations des salauds de méchants, caractérisés par le fait qu’ils massacrent un peu les gens pour passer le temps. Et Dieu que le temps passe lentement en Birmanie quand on assiste à tout ça. On m’avait parlé d’un film violent, et poutrin de sa génitrice, c’est un des plus violents et affreux que j’aie vus. Franchement, si vous êtes un poil sensibles, épargnez-vous ce spectacle, c’est limite insoutenable. Mais j’ai soutenu héroïquement pour vous, donc estimez-vous heureux, petits galopins.
Donc, à partir de là, le film bascule dans l’ultraviolence à outrance. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose : ça fonctionne même très bien dans pas mal de films de guerre ou d’horreur, et montrer la violence peut avoir un sens. Mais dans Rambo, je le cherche encore. Il y a peut-être une simple volonté de choc, mais pour moi, ça ne fonctionne pas, mais alors pas du tout.
Des mercenaires interviennent et doivent aller chercher les missionnaires capturés par l’armée birmane (et un petit peu torturés, mais quand même pas trop, à une exception notable : l’un d’entre eux se fait bouffer les pieds par des cochons). L’équipe de mercenaires rappelle pas mal ce qu’on a pu voir dans des films d’action des années 1980-90, mais la sauce prend difficilement : peu de temps pour développer ces personnages à l’exception d’un chef assez infect, mais qui révèle son courage en crachant à la tronche de l’officier birman.
Tout ce petit monde-là intervient dans le village tenu par l’armée, et nous assistons à une interminable scène d’humiliation de captives obligées de danser devant une foule de soudards avinés, jusqu’à ce que l’atmosphère sombre davantage et que les soldats se jettent sur elles et les molestent copieusement dans la perspective évidente d’un viol collectif.
Alors tout ça, après avoir vu l’assaut du village, les gosses jetés dans le feu, les corps démembrés par les éclats d’obus et tout le reste, ça commence à faire un poil too much. Or la scène d’humiliation s’éternise. Elle entrecoupe une longue séquence d’infiltration du village des méchants par les mercenaires, mais les « coupes » sont très longues chaque fois. Et chaque fois la vision devient plus malaisante, par effet de répétition sans que quoi que ce soit ne s’y ajoute réellement. Nous comprenons également que l’officier birman est pédophile, ceci au moyen de quelques plans heureusement moins directs : un gosse entre dans ses quartiers, la porte se ferme. On reverra le gamin repartir plus tard comme une ombre, au loin.
S’ensuit l’attaque du village, ça pète, ça se passe assez mal pour les mercenaires, puis, lors de la fuite, Rambo s’empare d’une mitrailleuse lourde et les rebelles locaux interviennent pour mettre leur raclée aux mercenaires. Raclée qui nous est montrée sous la même forme que l’assaut du village : corps démembrés par les balles, explosions, lance-flammes…
Arrivé à ce point, je n’avais plus qu’une envie : que ça se termine très très vite. Rambo repart en mode machine de guerre, il défouraille comme une escouade de marines à lui tout seul, et ça finit en bain de sang. Encore une fois, les scènes sont assez insoutenables et j’ai réellement subi les images plutôt que de les regarder.
Fin du truc : Rambo, comprenant qu’il est encore humain, rentre au ranch de son père et hop, crédits.
Immense déception.
J’attendais, derrière la violence, un message un peu plus subtil. OK, une partie du message passe bien : la guerre, c’est super moche et quand on est un petit privilégié à la con, c’est pas super malin d’aller répandre la bonne parole à l’autre bout du monde, parce qu’on se fait un petit peu tuer sauf s’il y a Rambo dans le coin.
Non, euh, sérieusement : je ne retiens du film qu’une série d’images ultraviolentes enchaînées sans but narratif, avec un montage assez foireux. Aucune réelle présentation des méchants, qui sont juste tout le temps des connards. Cela dit, on n’a pas énormément de pitié quand ils y passent, mais ça reste une maigre consolation après avoir encaissé le reste. A vrai dire, leur exécution à la sulfateuse par Rambo n’a rien de cathartique ni de satisfaisant. La fin du film m’a laissé curieusement froid, et j’ai attendu jusqu’au bout qu’il *se passe quelque chose*. N’importe quoi. N’importe quoi sauf un massacre/viol. Bref, une quelconque volonté de raconter un truc. Et je n’ai absolument rien vu de tout ça.
Par conséquent, soit j’ai loupé quelque chose d’essentiel (ça m’était arrivé sur le tout premier Rambo, qui m’avait bien plu, mais que je n’ai réellement compris qu’en le revoyant vingt ans plus tard), soit c’est vraiment un Rambo de plus, bien plus proche des deux opus précédents que du premier, qui reste un classique excellemment bien mené.
Au passage : âmes sensibles, sérieusement, abstenez-vous.
Midsommar

2e film joyeux et d’une gaité époustouflante du week-end : Midsommar, d’Ari Aster.
Ari Aster, c’est Hereditary, un film d’horreur choc qui m’a scotché à mon siège de ciné comme jamais à sa sortie, et qui m’a mis une gifle magistrale.
La bande-annonce de Midsommar laisse entrevoir à tout spectateur un peu aguerri le pitch du film : des Américains en vacances assistent aux festivités de l’été en Suède, mais évidemment, la communauté où ils se rendent n’est pas bien bien nette et ça va très mal se passer. Bref, c’est un coup à vérifier si personne n’est en train de monter un gros mannequin d’osier dans un coin. Wink wink.
Premier truc : c’est lumineux. Poutrin, on se prend de la lumière plein la tronche durant tout le film. Normal, c’est l’été, c’est en Suède, c’est lumineux. Une immense partie de l’action se déroulant dans un village qui ressemble en gros à un vaste pré avec quatre maisons et un temple en forme de dé à 4 faces (oui, une pyramide, roooh, mais ça marche aussi), on est souvent désorienté. Rien pour bloquer la vue : on voit très très loin, tout le temps, et on est aveuglé par le soleil une bonne partie du temps. C’est curieusement éprouvant pour les nerfs, d’autant que la tension monte au cours du film et que le malaise s’installe peu à peu, pour aboutir à une fin évidemment atroce.
Ari Aster a déclaré qu’il s’agissait non pas d’un film d’horreur (mec, t’as pas vu les cadavres dégueu qu’ont fait les SFX ou quoi ?) mais un film de rupture.
Et… mais ouais, c’est bien ça, en fait. Le couple de personnages, Christian (ha ha ha, un peu comme chrétien, en français ! Bien vu !) et Dani s’éloignent peu à peu, et cette dernière passe par tous les stades douloureux d’une rupture bien dégueulasse (Christian étant quand même un bien beau connard qui ne sait pas ce qu’il veut).
On éprouve une sensation de flottement désagréable tout le long du film : on se sent quasiment désincarné, avec ce paysage sans repères, où l’on ne peut se raccrocher qu’à la structure pyramidale et menaçante où tout va s’achever. Les habitants de Harga, la communauté suédoise, se livrent aux rites avec application, rigueur, mais souvent sans passion. Les sourires sont rares dans beaucoup de scènes, et surtout, aucun dieu particulier n’est mentionné. C’est un culte à la nature, aux cycles de la vie, mais qui, contrairement au culte chrétien (par exemple), n’anthropomorphise rien. L’homme n’y est pas l’image (ou à l’image) de dieu, mais un simple combustible. La promesse d’une réincarnation, d’un au-delà, peut-être, ne pèse pas bien lourd face aux réalités atroces que subit la chair dans le film : là aussi, beaucoup de scènes difficilement soutenables, à l’image de ce que proposait Aster dans Hereditary.
Cette communauté, nous la voyons pourtant avec du recul, dans des vignettes, parfois comme dans une maison de poupées (un thème présent dans Hereditary également), ce qui m’a fait penser aux films de Wes Anderson et à sa prédilection pour les décors/dioramas. Ari Aster est-il une sorte d’anti-Wes Anderson montrant des communautés qui n’existent qu’à un moment de rupture ? (Celle d’Hereditary subit plusieurs deuils qui mènent à la fin que vous savez si vous l’avez vu…)
Nous sommes à la fois prisonniers de l’action et extérieure à elle. Nous n’aurons pas d’explication concernant certains aspects de la communauté, et lorsque nous obtenons des réponses, c’est visuellement : le jeu de « skin the fool » évoqué en début de film prend un sens très concret à la fin, et nombre de visions aperçues sur des dessins se réalisent.
Le film dure 2h30 environ, mais passe comme une vision onirique : d’ailleurs, les personnages y sont très fréquemment sous l’emprise de diverses substances. Encore un thème de la chair malmenée, amenée à un point de rupture ? Je ne sais pas vraiment. Le film donne à réfléchir (et pas du tout envie d’aller en Suède ni chez des espèces de sectes cheloues, et c’est une super bonne pub antidrogue), et je ne serais pas surpris qu’il obtienne une sorte de statut culte au fil du temps. Une chose est sûre, on n’en ressort pas indemne, et on repart avec des questions, des hypothèses et peut-être même une remise en question personnelle.
Je ne peux pas non plus conseiller Midsommar si vous êtes un peu sensible : la violence y est assez malaisante, toujours en gros plan, et surtout, elle intervient très lentement, après une très longue préparation. Lorsque le pire se produit à l’écran, on a déjà eu très longuement le temps de le redouter, d’espérer y échapper. Et si jamais vous allez pisser en mettant en pause sur une scène pas jolie jolie, votre conjoint.e risque d’être traumatisé.e et de s’éclipser pour aller soi-disant chercher à boire (true story, et je n’ai jamais été aussi ravi que le frigo avec le Coca soit si loin de la télé).
Si vous n’avez pas peur des chocs, en revanche, c’est un bien meilleur film que John Rambo et il y a beaucoup moins de morts (mais vous ne risquez pas de les oublier…). Je vais suivre la carrière d’Ari Aster, qui affirmait récemment en avoir terminé avec l’horreur et vouloir se pencher sur d’autres genres (la SF notamment). J’ai hâte de voir ce que ça va donner…
Ça, chapitre 2
Ça y est (ha ha ha… non, je vais arrêter, et on va pas faire de blagues chaque fois que le mot « ça » intervient dans le texte), j’ai vu le second chapitre de Ça d’Andy Muschietti d’après l’œuvre de Stephen King. Alors ?
Bah alors c’est bien
J’avais beaucoup aimé le premier volet, qui replaçait très intelligemment l’intrigue dans les années 1980 plutôt que 1960, et qui devait donc adapter un certain nombre d’éléments de l’intrigue en conséquence. Le scénario, bien fichu, fonctionnait très bien, en particulier grâce à un casting impeccable qui, à mes yeux, éclipsait complètement celui de la première adaptation du roman, un téléfilm en deux parties avec Tim Curry (excellent dans le rôle de Grippe-sou le clown). Dans ce fameux téléfilm – qui s’en tirait honorablement malgré une fin euh… ben une fin aux effets spéciaux un peu fauchés, qui soufflaient un petit peu le caractère horrifique du truc –, le casting adulte fonctionnait à mon avis bien mieux que celui des enfants, vraiment en retrait.
Eh bien ici, c’est un peu l’inverse. Attention, je vais spoiler, donc il vaut mieux vous abstenir de lire ceci si vous souhaitez conserver la surprise.
Au début du film, nous assistons aux scènes qui ouvraient le roman de Stephen King : le premier meurtre, à caractère homophobe, est d’ailleurs particulièrement glaçant (et rappelle une réalité qui n’a peut-être pas autant changé qu’on le souhaiterait par rapport à l’époque de la sortie du livre… c’est-à-dire en 1986), et lui succèdent de petites scènes présentant les ratés adultes, menés par James McAvoy, qui joue désormais dans tous les films, partout, tout le temps. McAvoy est bon, et le reste du casting adulte aussi, du moins lors de ces scènes isolées.
Mais lorsque les ratés se réunissent, on a une drôle d’impression : l’alchimie entre les acteurs n’est pas là, ça ne fonctionne qu’à moitié. Je ne vous cache pas que la scène du restau chinois m’a vraiment fait peur, non pas à cause des bestioles, mais parce que les relations entre les personnages semblaient forcées, artificielles. Est-ce un parti-pris délibéré, visant à nous faire comprendre que ces adultes ne sont plus les enfants liés « à la vie, à la mort » que nous avions suivis dans le premier volet ? Je vous avoue qu’il me faudra sans doute un deuxième visionnage pour en juger, et surtout un visionnage en VO. La VF du premier volet était réussie, mais j’ai eu énormément de mal avec la voix française de Richie Tozier, interprété par Bill Hader, qui sonne comme un doublage de sitcom. Quoi qu’il en soit, d’innombrables petits détails m’ont sorti du film, au point que je m’attendais à une expérience un peu gâchée.
Et puis… et puis il y a eu les flashbacks. Le 2e volet comprend énormément de scènes du passé, avec les enfants du premier, et lorsque le lien s’établit entre eux et les adultes, lorsqu’il y a réellement passation de pouvoir entre les générations, quelque chose de très fort se produit. Les jeunes acteurs portent réellement le film, leurs versions adultes n’étant que le prolongement de ce qu’ils étaient, sans doute pour nous amener à cet amer constat que l’âge adulte, en nous faisant perdre nos illusions, nous arrache également ce qui fait notre force, en particulier dans notre relation franche à l’autre et dans nos amitiés. Le va et vient entre les deux époques est très efficacement mené, et on a plaisir à voir désormais dans les acteurs adultes l’écho de ce qu’étaient leurs personnages enfants. On se rend compte, au passage, d’une autre qualité formidable du casting : à l’exception de McAvoy, les acteurs adultes ressemblent beaucoup aux enfants (c’est frappant pour Eddie).
Au fil du récit, une vraie émotion s’installe, même si le réalisateur insiste – peut-être un peu trop souvent – pour la tempérer par des traits d’humour : le caméo de King, les échanges entre Eddie et Richie, les références très méta aux adaptations des romans de King à l’écran… Heureusement, les séquences d’horreur sont assez choquantes et bien menées pour que ces passages drôles (voire hilarants) ne sapent pas la substance du film. Le scénario est encore une fois très bien adapté (même s’il zappe énormément de choses, notamment concernant les conjoints de Bev et de Bill), avec toutefois un énorme changement, la révélation de l’homosexualité cachée de Richie : j’ai beaucoup aimé ce détail, amené intelligemment, et qui ajoute beaucoup d’émotion à la fin du film.
Oui, j’écris émotions toutes les deux phrases. Parce que le film m’a énormément ému.
Ça, le roman, c’est quelque chose qui a énormément compté dans ma vie. C’est un livre qui m’a beaucoup marqué, que j’ai lu et relu, que j’ai fini par lire en anglais, puis par relire, puis par re-relire. J’avais la chance d’avoir des amis qui étaient eux aussi fans de King, et nous parlions de Beverly, de Ben et de Bill comme s’il s’agissait d’amis que nous côtoyions tous les jours et non de simples personnages fictifs. Ils ont pris, à cette époque, une importance immense dans mon paysage littéraire et culturel. Lorsque j’ai vu Paul Bunyan à l’écran, ou les friches, ou Mme Kersh, eh bien tout ça résonnait dans ma mémoire.
Ca fait un peu plus de 27 ans que j’ai lu Ça pour la première fois, mais je me suis clairement identifié aux personnages adultes du film. Pour moi, ça fait 33 ans. On n’est pas à six ans près. Il y a 33 ans, moi aussi j’affrontais Grippe-sou pour la première fois, et même si j’étais déjà plus âgé que le club des ratés des friches de Derry, je m’identifiais à eux. 33 ans après, j’ai vécu ce que la vie nous réserve à tous dans l’intervalle où nous devenons adultes : traverser des moments difficiles, survivre, grandir… Des trucs évidents. Des trucs d’adulte.
Quand j’ai lu Ca pour la première fois, j’étais encore un
gosse, et il y a plein de choses qui m’échappaient. Mais retourner à Derry,
après toutes ces années, m’a vraiment remué. À cet égard, le film est à mes
yeux une immense réussite. Ca ne m’empêchera pas de relire le bouquin, encore
une fois, évidemment.
Et de remercier Muschietti, ses acteurs (Skarsgard notamment) et son équipe de
m’avoir fait faire ce beau voyage en Nostalgie. Bref, j’ai beaucoup aimé ces
deux films, et j’ai hâte de les revoir d’une traite lorsque le second sortira
en blouret (que j’écris comme je veux, na).
Bon, sinon, je lis beaucoup de JDR en ce moment, et en particulier des rétroclones (ce qui ne va pas forcément vous parler). Et j’ai très envie de vous parler sous peu de l’excellentissime « Les Carnets du Vastemonde » de John Grümph édité chez Chibi (qu’on trouve sur Lulu). Je n’ai pas le temps de m’étendre sur le sujet pour le moment, mais c’est le meilleur univers de high fantasy que j’aie lu depuis longtemps, alors que j’en avais un peu marre de ce genre. Je ne peux que vous recommander de vous jeter dessus, mais je vous dirai pourquoi bientôt si vous ne me croyez pas sur parole !
Double (ou presque) feature : Warm Bodies et Pontypool

La bonne surprise hier (et avant-hier parce que je m’endors devant les films, même les bons) : Warm Bodies.
Que nos amis Québécois ont titré « Zombie malgré lui ».
Ce qui est un très très mauvais titre.
Parce qu’en général, voire dans 100% des cas, on ne devient pas zombie par goût pour le cerveau tiède et la déambulation apathique dans les rues.
Mais bref.
Attention, ça va spoiler sur Warm Bodies (et un peu sur Pontypool, car je l’ai trouvé absolument nul au point de décrocher en 15 minutes, mais j’ai lu l’article qui le concernait sur Wikipédia).
Donc, Warm Bodies. Alors c’est une histoire de zombies toute con. Avec une intrigue de comédie romantique plaquée par-dessus. R est un jeune zombie relativement propre sur lui (même s’il passera son temps à barbouiller les joues de sa copine de jus de zombie qui ressemble un petit peu à du caca semi-liquide), Julie est une survivante qui ne rigole pas avec les cadavres. Ça ne peut vraiment, mais alors vraiment pas marcher DU TOUT entre eux.
Et évidemment, ça marche quand même (vous vous en doutiez), même si ça part assez vite en sucette, car le papa de Julie émet de vigoureuses réserves vis-à-vis des passions de type nécrophile, car il ne faut pas rigoler avec les morts vivants, un coup de dents est si vite arrivé.

Pourquoi ? Pour. Quoi ?
Il y a en général des trucs qu’on ne mélange pas. Par exemple, le camembert et le jus d’orange (qui vous mettent en bouche le goût du vomi, true story ©Amélie Nothomb, testé par votre serviteur, croyez-moi sur parole : c’est une très très mauvaise idée). Et il faut bien reconnaître que la comédie romantique et le film de zomblards, ça ne partait pas vraiment gagnant, comme combo. Les films de zombies sont généralement désespérés, cyniques, acides et franchement dégueulasses à regarder (c’est aussi ce qui fait leur charme). Les comédies romantiques sont… ben en fait tout le contraire, quoi.
Alors quelle idée de mixer les deux ? Je veux dire, autrement que par défi, pour donner un gimmick à un film et faire son crâneur ? Mmmh ?
Honnêtement, Warm Bodies est affublé d’un scénario bien moisi : pour guérir les zombies, il suffisait de leur donner de l’amour.
Sérieux.
Les zombies voient R et Julie, la main dans la main (maintenant que j’y songe, ça me fait penser à un vague truc, leurs noms à tous les deux, mais je sais vraiment plus quoi), et d’un coup, bim, ça les dézombise. Dézombifie. Dézomberlificote.
Bref : c’est pus des zombies, dites donc. Ah ben ça alors ! Si c’est pas un scénario de chiasse explosive, je sais pas ce que c’est !

Un dialoguiste qui surgit hors de laaaaa nuiiiiiit
Alors oui, en effet, c’est bien bien de la merde. Et c’est là qu’intervient un poutrin de dialoguiste qui défonce tout, grâce au pouvoir du second degré et du décalage entre l’image et le dialogue.
Dès le début, nous sommes dans la tête de R, qui narre tout ce qui se passe à l’écran. L’image est complètement premier degré (des zombies hagards qui déambulent, et se transforment parfois en squelettes bien flippants, qui vont représenter les adversaires communs des gentils zombies et des humains vivants), mais la narration, elle, se permet un humour absolument génial. À un moment, R se retrouve dans le camp des humains, et Julie le grime à coup de cosmétiques pour qu’il passe pour un vivant. R est bien sûr confronté à une sentinelle, qui éprouve de sérieux doutes quant à sa véritable nature. Tous deux se regardent, et R cherche quelque chose à dire afin de se faire passer pour un humain ordinaire. Finalement, il réussit à balbutier un « hi ! » pâteux, après une bonne dizaine de secondes de lag. Et sa voix intérieure, enthousiaste, commente : « Yeah ! Nailed it ! » Rien qu’en l’écrivant, je glousse encore.
Ce décalage, c’est la clef de tout l’humour du film, qui prend systématiquement le spectateur à contrepied, en usant et abusant d’effets de ce genre, et en soulignant l’excellent jeu de Nicholas Hoult (le Fauve dans les X-Men), parfait dans le rôle du zombie un poil plus futé que les autres.
C’est ce décalage qui fait passer des éléments de scénario complètement absurdes et permet de s’accrocher au scénario pas très fut-fut quant à lui.
Pas très fut-fut ? Eh bien, quand on y pense…
Les zombies ont toujours été l’incarnation de la masse décérébrée, de notre profonde stupidité en tant qu’espèce, et de notre vulnérabilité à l’asservissement… au point que nous soyons capables de devenir des êtres dépourvus de volonté même en l’absence de tyran pour nous diriger. Le message du film ne va pas chercher très loin : l’acceptation de l’autre, le dépassement de la zone de confort, et tout simplement l’amour, sont des clefs permettant d’échapper à la noirceur du monde. Ou à la dépression. Les zombies de Warm Bodies finissent par arracher leur peau et leur chair pour se transformer en squelettes voraces et monstrueux, les vrais « méchants » du film.
Tout ça n’a rien de bien réaliste, mais c’est tellement fun que ça fonctionne parfaitement, au point que j’ai très envie de revoir le film !
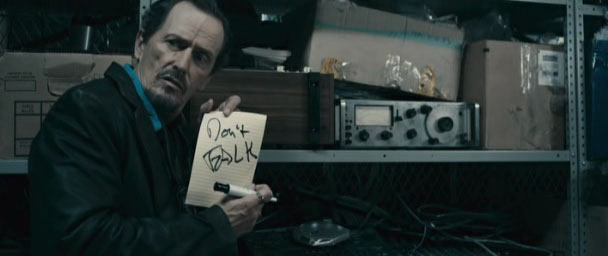
2e film (mais en vrai c’était le premier, mais en fait c’est devenu le zéroième, parce que je l’ai pas regardé) : Pontypool
Un film qui commence avec un super jeu de mots ne devrait jamais être mauvais. Ou plutôt, un film qui commence avec un super jeu de mots ne devrait pas rater aussi lamentablement ses scènes d’exposition.
Alors voilà, Pontypool est un film très intelligent, avec un postulat très sympa (vous pouvez le regarder vous-mêmes, mais si vous êtes comme moi et s’il vous fait affreusement chier, vous pouvez lire le résumé sur wikipédia, ça ne coûte rien et ce sera dommage de rater la chute de la blague). En fait, c’est un truc qui apparaît dans un supplément de l’excellent jeu de rôle Unknown Armies (2e édition), qui est le meilleur jeu de rôle du monde : le langage est/peut transmettre un virus. C’est très futé, il y a Stephen MacHattie avec sa tronche de salaud attachant, qui joue un salaud attachant, et c’est canadien, et souvent les Canadiens font des trucs vraiment cool.
Et là, c’est le drame.
Lors des quinze ou vingt premières minutes du film, nous faisons connaissance avec le personnage de MacHattie, animateur d’une station de radio, et nous suivons le début de son émission. L’essentiel de l’action consiste donc pour MacHattie à parler dans un micro, à vexer ses auditeurs et à s’engueuler un petit peu avec sa directrice des programmes.
Pendant huit heures trente.
Je sais, si on en croit le petit compteur qui indique la durée du film, en fait, ça dure 15 ou 20 minutes. Mais dans ma tête, c’était plus proche d’une demi-journée au soleil, enduit de miel avec des fourmis sur la bistouquette.

Ces dialogues complètement désincarnés (parce qu’ils sont prononcés par des acteurs statiques, dans un décor riquiqui, et en sus, ne racontent strictement rien d’intéressant, ou alors le font d’une façon super chiante) sont une authentique purge. Le scénariste, auteur du bouquin dont le film est tiré, a fait là un vrai boulot de romancer, c’est-à-dire, à mes yeux, un taf de merde, qui ne tient absolument aucun compte de la réalité cinématographique. Et cette réalité, brutale s’il en est, la voici : regarder un gus causer à l’écran pendant un quart d’heure, c’est juste super chiant.
Le réalisateur, pas fou, essaie de compenser sur cette durée, en appliquant une astuce toute con, mais qui fonctionne parfois : un bon vieux mouvement de caméra. Peut-être qu’en évitant le plan fixe, on va secouer un peu les spectateurs du fond ? La caméra nous fait donc des pseudo-travelings mous sur les personnages, conférant à la situation une sorte d’atmosphère d’urgence factice qui ne fonctionne pas du tout. Pour tout dire, au bout d’un moment, j’ai dû regarder ailleurs qu’à l’écran parce que ça commençait à me donner le tournis.
Et à la fin… ben je me suis tellement emmerdé que j’ai éteint et je suis passé à Warm Bodies. Warm Bodies, avec son scénar tout pourri et merveilleusement dialogué, filmé et interprété (sans parler d’une bande son épatante).
Moralité : si tu veux écrire un scénario de flime de ciména pour les gens qui ont envie de voir du ciména, il faut tenir compte des spécificités du média. Et là, pour moi, Pontypool passe à deux millions de kilomètres de la cible. J’ai beau me douter que le film est vraiment bien par la suite, je vois que l’idée est très pertinente et rigolote, mais si c’est pour me fader ce genre de plan pendant une heure trente, je vais m’abstenir. Et lire le résumé sur wikipédia, pour comprendre l’engouement pour le truc. Donc oui, bonne idée. Mais punaise, exposition merdissime, j’en démordrai pas (et je vous jure que j’avais envie d’aimer ce machin).
Voilà, c’était une chronique brève mais courte ! Si ça se trouve, vous avez adoré Pontypool et vous vous dites : oh là là, il exagère, quand même, hein ! Et… ben dans ce cas je sais pas trop quoi vous dire… Je vous envie un peu d’avoir supporté ce machin ?
Je n’ai rien à ajouter, excepté que j’ai repris la traduction pure et dure, et que j’ai cessé la relecture, qui m’épuisait et ne m’apportait strictement aucune gratification (comme boulot plus ingrat, je vois guère que cireur de moules ou ponceur d’huîtres). Et que c’est vraiment bien agréable !

Sandy Julien
Traducteur indépendant
Works in Progress
- Secret World Domination Project #1 44%